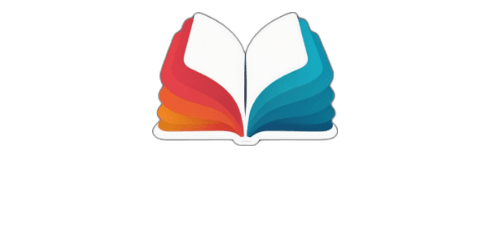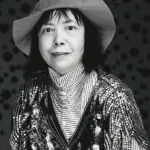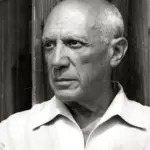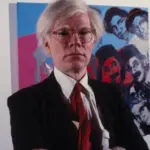Biodiversité et faune/flore
# La Biodiversité et la Faune/Flore en Martinique
## Introduction
La Martinique, joyau volcanique des Petites Antilles, abrite une biodiversité exceptionnelle, reconnue comme l’un des 34 points chauds de biodiversité de la planète. Le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM), créé en 2012 et couvrant environ 63 000 hectares sur 32 des 34 communes de l’île, joue un rôle central dans la préservation de cette richesse naturelle. Située sous les tropiques, l’île bénéficie d’une position insulaire qui a favorisé une diversification des espèces, avec un fort taux d’endémisme dû à son isolement géographique. Cette diversité englobe une faune et une flore variées, adaptées à des écosystèmes contrastés allant des forêts humides de montagne aux mangroves côtières. Cependant, cette biodiversité fait face à des menaces anthropiques et environnementales, rendant les efforts de conservation indispensables. Ce résumé explore en détail ces aspects, en s’appuyant sur les caractéristiques du PNRM, pour sensibiliser à l’importance éducative de cette patrimoine naturel unique.

## Développement
Les écosystèmes de la Martinique sont marqués par une grande variété, influencée par la topographie volcanique de l’île, divisée en deux grands ensembles : un nord escarpé et boisé, culminant à 1 397 mètres avec la montagne Pelée, et un sud plus plat et agricole. Ces milieux abritent une faune et une flore d’une richesse remarquable, avec un fort endémisme, mais aussi des pressions croissantes dues aux activités humaines.
Les forêts constituent l’écosystème dominant, représentant une succession écologique typique des Petites Antilles. Au nord, sur les flancs de la montagne Pelée et des pitons du Carbet, un couvert forestier continu s’étend du niveau de la mer jusqu’à plus de 1 300 mètres d’altitude, avec seulement 28 % de fragmentation. Cette continuité permet d’observer une gradation altitudinale des végétations : la forêt littorale et sèche en bas, suivie de la forêt mésophile (sempervirente saisonnière tropicale), puis de la forêt ombrophile tropicale (humide, recevant 3 000 à 6 000 mm de pluie par an), et enfin la forêt ombrophile de montagne et les fourrés des « elfes » en altitude, où les nuages omniprésents créent un paysage fantastique avec des arbustes bas et des broméliacées abondantes. La forêt ombrophile, par exemple, est dominée par des arbres atteignant 40 mètres de haut, comme le gommier blanc (Dacryodes excelsa), le bois de rivière (Chimarrhis cymosa), le châtaignier (Sloanea truncata) ou le magnolia (Talauma dodeca petala), accompagnés de fougères arborescentes et d’épiphytes nombreux. La forêt sèche, relictuelle sur le littoral caraïbe, est caractérisée par une pluviométrie de 1 000 à 1 500 mm avec une longue période de sécheresse, et abrite des espèces comme le gommier rouge (Bursera simaruba), le figuier maudit (Ficus laevigata) ou les poiriers (Tabebuia pallida et T. heterophylla). La forêt mésophile, souvent secondaire en raison des anciens défrichements pour cultures, inclut des arbres comme le bois-blanc (Simarouba amara) et le pois-doux (Inga laurina). Ces forêts, en grande partie primitives au nord, sont protégées par des réserves biologiques intégrales, comme celle de la montagne Pelée couvrant 2 301 hectares.
Les zones humides, recensées à 1 230 en 2012 sur une surface de 2 700 hectares, forment un autre écosystème clé, incluant mares, marais, étangs, ripisylves et lagunes, souvent d’origine artificielle ou saisonnière, avec des eaux douces, saumâtres ou salées. Elles abritent une végétation hygrophile et servent d’escale pour l’avifaune. La mangrove, un sous-ensemble emblématique, s’étend sur 1 800 à 2 100 hectares, principalement dans la baie de Fort-de-France (1 100 hectares) et la baie du Galion à La Trinité. Organisée en trois ceintures – palétuvier rouge près de la mer, puis noir et enfin blanc et gris –, elle repose sur un substrat argileux ou argilo-sableux et fournit des services écosystémiques essentiels, comme la stabilisation côtière (estimée à 8 064 €/ha/an) et un soutien à la pêche (15 143 000 € pour la pêche professionnelle). La baie de Génipa, dans la baie de Fort-de-France, concentre 65 % des mangroves martiniquaises, avec 153 espèces végétales et 93 espèces d’oiseaux, dont des aigrettes neigeuses, hérons verts et aigrettes bleues.
La faune est tout aussi diversifiée. Dix-sept espèces de mammifères terrestres ont été recensées, dont une chauve-souris endémique, le murin de Martinique (Myotis martiniquensis). Vingt et un reptiles et six amphibiens occupent ces milieux variés, avec l’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima), endémique de la Martinique, de la Guadeloupe et de quelques îles voisines, considéré comme vulnérable par l’UICN en raison de l’hybridation avec l’iguane vert introduit (Iguana iguana), une espèce exotique envahissante. Parmi les amphibiens, la grenouille Allobates chalcopis est endémique de la montagne Pelée. Les arthropodes sont abondants : 16 crustacés, une centaine d’araignées et mygales (dont le matoutou falaise, Caribena versicolor, arboricole endémique avec un abdomen rouge vif et des pattes rose violacé atteignant 15 cm d’envergure, dont les soies sont urticantes), 1 139 hexapodes dont 30 odonates, 40 lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), plus de 300 hétérocères (papillons de nuit), au moins 14 hyménoptères apoidea et 18 coccinelles. Au moins 95 espèces d’hexapodes sont strictement endémiques, comme le papillon Castnia pinchoni. Plus de 60 espèces d’oiseaux nicheurs fréquentent l’île, avec des endémiques comme le moqueur gorge-blanche (restreint à la forêt sèche de la presqu’île de la Caravelle) et l’oriole de Martinique (ou carouge, de la famille des Icteridae). Les îlets de Sainte-Anne sont des sites de nidification pour des oiseaux marins comme le phaéton à bec rouge, la sterne bridée, le puffin d’Audubon, le noddi brun et la sterne fuligineuse.
La flore compte 1 238 spermatophytes et 259 ptéridophytes autochtones, dont 396 espèces d’arbres (20 % endémiques des Petites Antilles, faisant de la Martinique l’île la plus riche pour ce groupe). Trente-neuf espèces sont endémiques à l’île, 177 aux Petites Antilles et 172 aux Antilles. En 2010, 56 arbres étaient en danger d’extinction locale et 12 en danger total. Parmi les endémiques végétales, la broméliacée épiphyte Aechmea reclinata, découverte récemment par les botanistes du PNRM, a perdu une grande partie de son aire due au défrichement illégal.
Les menaces pèsent lourdement sur cette biodiversité. Onze espèces ont disparu localement, selon l’UICN : le lamentin (Trichechus manatus), l’ara (endémique aux Antilles), l’amazone de la Martinique, la chevêche des terriers et le boa constrictor. Trente-huit pour cent de la faune vertébrée est introduite par l’homme, jugée néfaste, comme l’iguane vert qui menace l’iguane délicatissima par hybridation, ou des plantes invasives dans les zones humides : jacinthe d’eau, Pistia stratiotes, Hydrilla verticillata et Salvinia molesta. L’usage intensif de pesticides, notamment la chlordécone dans les bananeraies, a causé une pollution importante, affectant sols et eaux. Les défrichements historiques pour l’agriculture (banane, canne à sucre) et l’urbanisation fragmentent les habitats, particulièrement les forêts sèches et mésophiles.
La conservation est au cœur des actions du PNRM. Des aires protégées couvrent l’île : la réserve naturelle nationale de la presqu’île de la Caravelle (créée en 1976, gérée par le PNRM), celle des îlets de Sainte-Anne (1995, gérée avec l’ONF), l’étang des Salines (site Ramsar), et la réserve marine du Prêcheur – Albert Falco. Vingt-quatre sites sont protégés par arrêtés préfectoraux de biotope, quatre classés et onze inscrits. L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2023 des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du Nord (12 % du territoire martiniquais) renforce la protection d’espèces menacées et pourrait augmenter le tourisme de 30 à 40 %. Le label « zéro chlordécone », lancé avec une application smartphone en 2019, garantit l’absence de ce polluant dans les produits alimentaires. La « marque parc », depuis 2012, labellise le miel, la viande d’agneau et le manioc avec des contrôles de qualité. Des opérations mensuelles « Touloulou » depuis 2012 ramassent les déchets sur le littoral avec 50 bénévoles par édition. Le PNRM soutient aussi l’agriculture durable, comme les haies vives dans les élevages ovins et la réintroduction d’ânes pour le transport en zones escarpées.
## Impacts
Les menaces ont des impacts profonds : les espèces invasives réduisent la biodiversité locale, comme l’hybridation menaçant l’iguane endémique, tandis que la chlordécone pollue les sols, affectant la faune du sol et les chaînes alimentaires, avec une biodiversité plus faible dans les bananeraies malgré une amélioration post-interdiction (densité élevée d’herpétofaune mais faible pour les arthropodes). Les extinctions locales, comme celle de l’amazone, diminuent la résilience des écosystèmes. À l’inverse, les mesures de conservation génèrent des impacts positifs : la mangrove protège les côtes et soutient l’économie (pêche et tourisme), tandis que l’inscription UNESCO favorise le développement économique via l’écotourisme. Les labels et ramassages de déchets préservent les habitats, bénéficiant à 100 000 habitants et augmentant la sensibilisation éducative.
## Conclusion
La diversité de la faune et de la flore en Martinique illustre la fragilité et la beauté des écosystèmes insulaires tropicaux, avec un endémisme exceptionnel mais menacé par les introductions invasives, la pollution et les défrichements. Grâce au PNRM et à ses initiatives – réserves, labels et partenariats internationaux comme la convention de Carthagène –, une voie de préservation s’ouvre, intégrant conservation et développement durable. Éduquer sur ces enjeux est essentiel pour que les générations futures apprécient ce patrimoine, soulignant l’urgence d’actions collectives pour maintenir l’équilibre écologique de l’île.